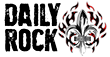Ils nous arrivent souvent, en tant que critiques ou simples amateurs, de comparer un groupe à un autre. Ce réflexe est tout à fait normal, compte tenu du fait que nous cherchons référence. Et puis, bien que nous voulions constamment dénicher de nouveaux trucs pour rassasier notre appétit de musique et de culture, nous avons tous ce petit diablotin sur l’épaule qui nous murmure à l’oreille : «allez, vas-y, écoutes ça, ça ressemble à quelque chose que tu aimes, ne résiste pas à la tentation!».
Dans le cas qui nous intéresse, les comparatifs affluents. Un bon nombre d’étoiles dans la constellation du progressif-fusion peut d’ailleurs nous aiguiller adéquatement. On sent bien quelques influences de Yes ou de Gentle Giant dans la musique du quintet torontois, mais il n’en demeure pas moins ardu de caser Druckfarben dans un créneau unique. D’une chanson à l’autre, il y existe même un certain écart qui fait en sorte qu’on éprouve une certaine difficulté à admettre qu’il s’agisse d’un album élaboré par un seul et même groupe. C’est en fait là que réside la magie de la formation.
La versatilité de ses musiciens est époustouflante, voire déroutante. Dans leur premier album (Druckfarben, 2011), on pénètre dans un univers très 1970 où les airs d’orgue fusent de toutes parts à la manière de Deep Purple, des Doors ou du Pink Floyd des premières années. Comme s’ils voulaient nous montrer de quoi ils sont capables, les premiers airs de l’album sont très près d’un jazz fusion éclaté et rebondissant dans tous les sens. ELPO et la très joviale Influenza les deux premiers morceaux du long-jeu, en freinera peut-être quelques-uns par leur composition très complexe, leur phrasé ampoulé et presque baroque (à ceux-là je dis : osez explorer plus loin dans l’album, vous y trouverez un contenu plus adéquat pour vos oreilles!). Les fans de jazz et de rock expérimental qui ne craignent pas les bizarroïdes de type Zappa ou The Aristocrats y trouveront cependant leur compte, mais seront déçus par la suite. L’intégralité de l’album est en ce sens un peu inégal, puisque les deux premières pistes détonnent trop drastiquement de l’ensemble. Les uns n’aimeront que ces morceaux et butteront sur les autres peut-être trop ‘commerciaux’, alors que d’autres cesseront net l’écoute de ce petit bijou, croyant qu’il s’agit de jazz fusion pur et dur (ce qui n’est certes pas le cas).
En revanche, le reste de l’album gravite dans des orbites aux sensibilités et audace moins nuancées (ce qui en soulagera quelques-uns). C’est du moins ce qu’on obtient avec les balades fort accrocheuses que sont Seems so real et Nat Nayah, deux pièces transitoires qui rappellent respectivement les célèbres The Police et Styx (dans Nat Nayah, on croirait même que Dennis DeYoung a été invité au micro). À la façon d’un esprit maniaco-dépressif, Druckfarben nous emporte dans des endroits totalement différents.
***
Accroché au premier album du groupe pendant plusieurs mois, il m’a été difficile de me lancer dans l’écoute de Second Sound, le second opus du groupe. Si j’étais un anglophone un peu sarcastique, j’oserais dire que «I had many second thoughts before listening to Second sound»; bref, j’étais hésitant. Il en est ainsi lorsqu’on est séduit par un premier album. On espère hautement de celui qui va suivre, on anticipe avec trop d’attentes. L’introduction de An answer dreaming, le premier morceau du disque, m’a d’abord laissé froid. Aux deux premières minutes, j’y décelais d’emblée un manque d’énergie, un manque d’assurance dans la performance de ces musiciens canadiens qui m’avaient pourtant épaté auparavant. J’avais également l’impression que la réalisation du disque était moins travaillée, que le mixage n’était pas tout à fait réussi. C’est du moins ce que je constatais au premier abord, puisqu’il me semblait que les claviers de Will Hare prenaient à tort le dessus sur la guitare et la basse.
Or, comme je suis d’un naturel têtu et que j’affectionne tout particulièrement la musique qui ne peut être appréciée à la première écoute, j’ai poussé mon exploration musicale plus avant (je suis né ainsi, favorisant l’inaccessibilité d’une œuvre potentiellement prometteuse plutôt que la facilité d’ingestion d’une pièce commerciale qui manque de caractère a posteriori). Ma ténacité fût récompensée au bout de quelques minutes, alors que le premier morceau n’en était qu’à la moitié. La léthargie musicale qui m’avait abattu au départ, et la longueur du segment introductif de ladite pièce, allaient bientôt céder la place à l’énergie très «seventies», très Supertramp de la suite. Malgré la mise en bouche exagérément étirée de ce premier titre (un bon 2 minutes de mollesse injustifiée), l’éclosion du beau et du jouissif s’est réalisée. Je n’étais pas encore habilité à constater mon soudain plaisir que Disbelief, un morceau d’un génie musical épatant, s’est invité dans le pavillon de mon oreille. Parsemée d’harmonies assurées simultanément par les claviers et les guitares qui se répondaient en canon, la pièce se complétait par une batterie démente assurée par un Keith Moon ressuscité des morts (oui, le batteur de Druckfarben peut être comparé au batteur des légendaires Who, suffit de concentrer son écoute sur les lignes de batteries de cette pièce spécifique pour le constater… c’est irréfutable!). À compter de ce moment, je sus que le ton était donné au reste d’un album visiblement lumineux et mémorable dont la beauté ne commençait qu’à se révéler (j’étais soulagé!).
Les membres de Druckfarben sont ouvertement fans de Yes, de Genesis, de progressif et de classic rock des années 1970 (et c’est ce qui les a réunis en 2008, lors d’un spectacle-hommage à Yes). La teinte de cette époque transparaît d’ailleurs dans chaque pièce. Il arrive néanmoins que la touche «druckfarbienne» se révèle derrière toutes ces influences, comme dans Surrounds me et Another Day, deux pièces submergées par une avalanche d’arpèges et une confusion instrumentale générée par une polyrythmie soutenue. Et c’est lorsqu’ils s’expriment librement sans trop de références, avec leur propre voix, que leur inventivité et leur virtuosité sont les plus remarquables.
À ce titre, Dandelion est un morceau fort technique et fort audacieux qui rejoindra un large bassin de fans. Constitué d’une introduction où la ligne de basse est décalée de plusieurs tonalités, au point d’avoir l’impression que les cordes de l’instrument sont engluées d’une matière inconnue, l’ensemble du morceau impressionne par son inventivité et son atmosphère énigmatique. Débutant par une ambiance dans la veine des mythiques King Crimson, le morceau évolue et présente l’aspect plus exploratoire du quintet canadien alors qu’Ed Bernard s’exécute au violon avec le doigté d’un musicien manouche, avant de reprendre sa guitare où un efficace effet de wah-wah vient rehausser le tout d’une énergie créatrice manifeste.
Pour leur part, une partie des pièces Long walk down et Second sound, démontrent le côté plus délicat et plus sentimental du groupe. Pièces truffées de piano, elles offrent un aspect intime et moins technique qui donne un répit à l’esprit pour rejoindre plutôt le cœur du mélomane, l’espace d’un moment. Intenses et harmonieuses, elles témoignent d’une sensibilité similaire à celle de Freddy Mercury, tant au niveau de la voix que de la composition au piano.
Cependant, comme rien n’est parfait, certains segments de chansons me semblent superflus, voire irritants. C’est le cas de de l’introduction de Surrounds me, la pièce finale de l’album. Il faut subir 3 minutes d’un air folklorique irlandais au violon qui jure absolument dans le décor avant d’entrer dans le vif du sujet. Puis, subitement, le violon se tait, comme s’il sentait que sa présence n’était pas nécessaire. Puis, à la onzième minute, voilà que surgit de nulle part une mesure de banjo! Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Je déteste personnellement ce type d’intrusion accessoire dont font usage un trop grand nombre de multi-instrumentistes. Je déteste également cette habitude qu’ont les musiciens de génie à étendre la durée d’un morceau à plus de 15 minutes, surtout lorsqu’au bout de la dixième minute, on constate que le reste du morceau est totalement indépendant et qu’il aurait pu faire une pièce à part. La raison d’un pareil bricolage réside-t-elle dans un pari de faire une chanson de près d’une demi-heure, ou n’est-ce qu’un «trip» d’artiste qui m’échappe? Je l’ignore. Mais cela m’énerve légèrement.
Qu’à cela ne tienne, cet album m’a finalement plu. Le groupe offre des débuts d’albums qui n’arrivent certes pas à convaincre de visu. Mais pour celui qui s’obstine à écouter plus avant pour se faire une meilleure idée du disque, une belle récompense l’y attend. Car cet album est un essentiel pour l’amateur de jazz, de vieux prog des années 70 et d’un classic rock d’une rare intelligence. Tantôt très poussées sur un jazz fusion élitiste et difficile d’approche, tantôt orientées sur un rock progressif mélancolique et abordable, les compositions du groupe canadien méritent néanmoins une place dans le panthéon international du progressif au cours des prochaines décennies. Pour les fans de rock progressif old school, Druckfarben est ce que l’on pourrait appeler un «instant classic». À mon humble avis, seul le mélomane déterminé et averti pourra s’y frotter. J’en suis, et je ne suis pas le seul.
N.B. : pour les fans de Genesis, Yes, Gentle Giant, Styx, King Crimson et autres géants de cet âge d’or du prog et du classic rock!
Dany Larrivée
Chroniques parues simultanément chez Daily Rock Québec et Clair & Obscur (France).